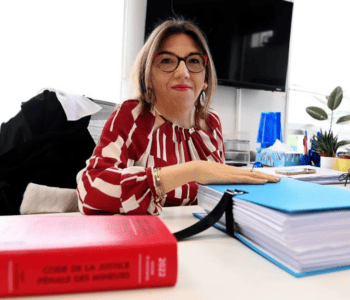Sexisme administratif : que dit la loi ?
📰 Extrait d’article paru sur Madmoizelle.com
Éclairage de Maître Marie Blandin, avocate en droit de la famille au Barreau de Rennes
Madmoizelle : En quoi consiste le sexisme administratif ? Existe-t-il une définition ?
Me Marie Blandin. À ma connaissance, il n’existe pas de définition légale. Je le définis comme une différence de traitement des usagers du fait de leur genre, généralement au détriment des femmes qui se voient imposées des obligations ou restrictions par rapport aux hommes. En ce sens, l’usage du nom est très significatif. C’est-à-dire que dans la loi, l’usage du nom du conjoint fait l’objet d’une parfaite réciprocité. Mais dans la pratique, ce n’est pas le cas. Il est par exemple extrêmement rare qu’un homme prenne le nom de famille de son épouse. En revanche, ce droit parfaitement réciproque est perçu par beaucoup d’administrations comme une obligation pour les femmes d’utiliser le nom de leur époux.
Certaines évolutions récentes de la loi sont-elles aujourd’hui favorables aux femmes, pour éviter le sexisme administratif ?
Me Marie Blandin. Les lois sont égalitaires, mais la pratique ne l’est hélas toujours pas. Cela peut être dû à une méconnaissance de la part des agents d’administration, à de mauvaises habitudes… Ce qui conduit à des pratiques illégales. Des circulaires sont régulièrement réalisées pour rappeler les nouveaux usages, mais encore faut-il qu’elles soient lues et appliquées.
J’ai beaucoup de clientes qui me disent avoir perdu leur nom de naissance et se demandent quand est-ce qu’elles vont le retrouver. Or, on ne perd pas son nom de naissance : on obtient une faculté supplémentaire d’utiliser le nom de la personne que l’on va épouser. Or, dans les faits, les administrations en arrivent parfois à dire aux femmes qui divorcent que si elles veulent reprendre exclusivement leur nom de naissance, elles doivent présenter le jugement ou la convention de divorce. C’est faux : elles n’ont pas besoin de ces dociments pour pouvoir reprendre l’usage exclusif de leur nom de naissance. J’ai récemment eu le cas d’une élue municipale pour laquelle j’ai été obligée de faire un courrier à la mairie car en conseil municipal, on continuait à l’appeler sous son nom d’épouse alors que d’une part elle était divorcée, et d’autre part parce qu’elle avait mentionné plusieurs fois qu’elle souhaitait reprendre l’usage de son nom de naissance. Mais on lui répondait que parce qu’elle avait été élue sous ce nom-là, ça n’était pas possible de changer. Ils ont fini par modifier.
Mais je ne suis pas non plus pour demander à tout prix à une femme qui divorce et vit donc une période qui n’est pas facile de se battre pour reprendre l’usage exclusif de son nom de naissance. Sacrifier les gens sur l’autel de nos convictions n’est pas non plus la bonne solution. J’entends que beaucoup de femmes préfèrent attendre le jugement de divorce, pour ne pas se lancer dans des démarches qui vont leur prendre beaucoup d’énergie. Mais de l’autre côté, si on ne met pas non plus le nez des administrations dans leurs mauvaises pratiques, les choses n’évolueront pas.
Ces situations sont-elles d’autant plus difficiles à vivre en cas de séparation conflictuelle ou dans un contexte de violences conjugales ?
Me Marie Blandin. Oui, dans ces situations, il y a un ressenti d’urgence à reprendre son nom de naissance. Quand on est dans l’apaisement, un divorce avec consentement mutuel se règle aujourd’hui en deux mois. Mais cela peut prendre des années en situation conflictuelle. Reprendre son nom de naissance dans ce contexte est une façon de marquer la séparation vis-à-vis des tiers. Mais cela pose aussi après aux femmes le problème des noms des enfants. Parce qu’aujourd’hui, la pratique majoritaire reste de donner le nom du père uniquement. Et d’ailleurs, beaucoup de personnes pensent que lorsqu’il y a un désaccord sur cette question entre les parents, donner le nom du père prévaut avant le nom de la mère. Or, les noms sont donnés par ordre alphabétique.
En ce sens, la loi relative au choix du nom issu de la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2022 est une vraie évolution. Désormais, on peut changer de nom pour ajouter celui du second parent et ce, sans que l’autre parent n’ait à donner son accord. C’est donc mieux vécu par les femmes qui se séparent de leur conjoint, car elles ont la possibilité de leur transmettre leur nom de famille.
Quid de la disparition de « Mademoiselle » dans les documents administratifs ?
Me Marie Blandin. Parce qu’il faisait une distinction entre les femmes mariées et celles qui ne l’étaient pas, le terme « Mademoiselle » est vraiment révélateur du sexisme administratif. Il n’y a pas de distinction entre les hommes selon qu’ils soient mariés ou non ! C’est un terme qui n’avait aucune justification, si ce n’est celle de notre héritage patriarcal. Une circulaire du 21 février 2012 préconise d’ailleurs l’évitement de « Mademoiselle », au même titre que les expressions de « nom de jeune fille », « nom d’épouse » et « nom patronymique ».
Que faire en cas de sexisme administratif avéré ?
On peut faire un courrier pour demander une modification. Généralement, lorsque qu’un·e avocat·e l’écrit, cela suffit. Après, face à un organisme récalcitrant, on pourrait envisager de saisir le tribunal administratif pour enjoindre des astreintes. Si cela porte un préjudice particulier, il est aussi possible d’envisager d’engager une action d’indemnisation, ne serait-ce que pour avoir fait cinquante courriers afin d’obtenir le changement de nom demandé.
Après, le sexisme constitue un délit. On peut donc, si le sexisme d’un banquier ou d’un agent administratif atteint un certain degré, invoquer le délit d’outrage sexiste selon le 222-33-1-1 du Code pénal. Car le sexisme administratif peut aussi être une manière de harceler une personne avec qui on a un désaccord. Je pense notamment à ce cas de l’élue municipale, qui faisait partie de l’opposition, et à qui on a refusé l’usage exclusif de son nom de naissance. Cela peut être considéré comme une forme de harcèlement sexuel (article 222-33 du Code Pénal) ou de harcèlement moral (article 222-33-2-2 du Code Pénal).
Existe-t-il encore des administrations ayant des formulaires où « Monsieur » prévaut sur « Madame » ?
Me Marie Blandin. Il me semble qu’aujourd’hui, on est davantage à jour au niveau des formulaires Cerfa. Cela peut peut-être arriver au niveau de petites structures, d’associations, qui n’ont pas encore mis à jour leurs formulaires. Dans ces cas-là, je pense qu’il faut simplement écrire à l’organisme pour alerter sur la non-conformité du formulaire selon les normes actuelles d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
D’autres évolutions dans la loi sont-elles aujourd’hui souhaitables pour en finir avec le sexisme administratif, comme l’écriture inclusive ?
Me Marie Blandin. Oui, je pense que l’égalité passe aussi par le langage. Je fais partie des avocates qui ont mis un petit « e » à « avocate » bien avant que ça ne soit autorisé par le Conseil national des barreaux. Ces actions symboliques comptent. La féminisation du vocabulaire, notamment pour les métiers, est selon moi essentielle.
Quels conseils juridiques donneriez-vous aux femmes qui font face au sexisme administratif ?
Me Marie Blandin. En premier lieu, il faut écrire pour garder une trace, ne pas simplement faire la demande orale à un conseiller, par exemple. Il faut aussi se référer à la loi pour montrer qu’il ne s’agit pas d’un ressenti, d’une envie, d’une lubie. Et qu’il existe des circulaires, des textes sur lesquels les femmes peuvent s’appuyer.